Jean-Pierre Filiu : « Ce sont les peuples arabes qui pourront défaire Daesh » – par Olivia Recasens
Selon l’historien, le totalitarisme de Daesh finira par céder, car son modèle est intenable et conduit à une impasse sociale et économique. Explications.
Jean-Pierre Filiu, professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris, publie Les Arabes, leur destin et le nôtre(La Découverte, 250P., 14 euros). Ce fin connaisseur de l’islam contemporain y lève le voile sur une histoire du monde arabe largement méconnue, celle des contestations démocratiques et des révoltes sociales écrasées dans le sang, bien avant « les Printemps arabes ». Entretien.

Le Point : Les sociétés arabes ont fait en quarante ans leur transition démographique, là où l’Europeoccidentale avait mis deux siècles. Une mutation accélérée qui, selon vous, a des conséquences explosives ?
Jean-Pierre Filiu : En effet, durant les deux générations qui couvrent la période 1970-2010, le monde arabe a accompli en silence une transition démographique que l’Europe a mis deux longs siècles à réaliser. Cette émergence d’une jeunesse éduquée et critique, parlant la même langue arabe depuis le Maroc jusqu’au Golfe, a permis l’extraordinaire diffusion de la mobilisation démocratique au cours de l’hiver 2010-2011, avec une contagion militante d’un pays à l’autre. J’ai cependant souligné d’emblée qu’il n’y avait aucun « effet domino », mais une dynamique régionale de contestation où les jeunes adultes, de 20 à 35 ans, souvent mères ou pères de famille, tenaient la ligne de front face à une classe politico-militaire discréditée.
Comment expliquez-vous l’exception tunisienne qui résiste, malgré le travail de sape du terrorisme islamiste ?
Là aussi, je reviens au temps long de l’histoire. Le maître mot de l’évolution tunisienne depuis un siècle et demi est « Constitution », en arabe « Destour », le nom même du parti nationaliste mené par Habib Bourguiba. Durant les trois premières années de leur transition démocratique, les Tunisiens n’ont voté qu’une fois, pour élire une Constituante, en octobre 2011. Cette assemblée fondatrice de la Deuxième République tunisienne a adopté en janvier 2014 une nouvelle Constitution qui n’a, fort heureusement, jamais été soumise au référendum. En Égypte, au contraire, trois Constitutions ont été soumises par référendum entre 2011 et 2014, et chaque fois adoptées malgré leurs dispositions contradictoires. La Tunisie a refondé son pacte social, ce qui lui permet d’enraciner dans une légitimité populaire sa résistance à l’horreur djihadiste. L’Égypte, en revanche, est revenue à des niveaux de violence inconnus… depuis l’expédition de Bonaparte en 1798, tandis qu’un demi-million de militaires égyptiens se révèlent incapables de réduire un millier d’insurgés djihadistes.
Au XIXe siècle, la Tunisie et l’Égypte ont été le foyer d’une Renaissance, baptisée « les Lumières arabes ». Pourquoi cette flamme s’est-elle si vite éteinte ?
En Tunisie comme en Égypte, le XIXe siècle voit des dynasties modernisatrices, autonomes de fait envers l’Empire ottoman, mettre en œuvre un ambitieux programme de réformes administratives, éducatives, foncières ou industrielles. La Tunisie abolit l’esclavage deux ans avant la France (en 1846) et elle adopte la première Constitution du monde arabe en 1861. Mais le protectorat imposé par la France en 1881 puis l’occupation britannique de l’Égypte en 1882 brisent ces deux expériences de « modernisation par le haut ». Les « Lumières » poursuivent cependant dans une effervescence intellectuelle et politique qui conduira à la « Révolte arabe » de 1916. Les Arabes entrent alors en guerre contre les Turcs, aux côtés des Français et des Britanniques qui trahiront leurs promesses de « Royaume arabe » indépendant, une fois la défaite de l’Empire ottoman consommée.
Quant à la Syrie, la grande erreur de la France selon vous est d’avoir refusé de reconnaître le CNS, le Conseil national syrien, alors qu’il est « infiniment plus transparent et représentatif que le CNT Libyen » ?
Nicolas Sarkozy n’a effectivement rien compris à la lame de fond qui traverse le monde arabe au début de 2011. Il soutient le dictateur Ben Ali au-delà de la décence, puis, pour se « racheter » de ces errements, s’engage sans réserve aux côtés du Conseil national de transition (CNT) libyen. Mais il s’agit d’un calcul de politique intérieure, afin d’endosser les habits d’un chef de guerre victorieux. L’enlisement de la guerre en Libye et les violences qui accompagnent la chute de Kadhafi d’août à octobre 2011 amènent ce président trop pressé à se détourner des révolutions arabes. C’est d’autant plus regrettable qu’une reconnaissance accordée par la France au Conseil national syrien (CNS), sur le modèle de celle conférée au CNT, aurait assuré à l’opposition syrienne une représentativité alternative et lui aurait permis d’agréger les dissidents et de brider les militaires. Au lieu de cela, Sarkozy a maintenu formellement les relations diplomatiques avec le régime Assad et il a fallu l’élection de François Hollande, en mai 2012, plus d’un an après le début de la révolution syrienne, pour que les ambassades soient fermées entre les deux pays.
Fin juillet, vous étiez au camp de Zaatari en Jordanie, où vous avez enseigné l’histoire arabe à des réfugiés syriens. Que vous a appris cette expérience ?
J’étais très impressionné par la maturité de cette centaine de jeunes adultes, hommes et femmes, qui ont tout perdu dans leur Syrie d’origine et qui, malgré tout, privilégient le débat respectueux sur la polémique accusatrice. Ils participent de cette nouvelle génération qui ne cédera pas avant d’accéder à une émancipation authentique, trop longtemps déniée. Les terribles épreuves auxquels ces étudiants d’un été ont été soumis leur ont aussi ouvert les yeux sur les mythes d’un certain « nationalisme arabe », en fait oppresseur et rapace, qui trouve pourtant encore de nombreux défenseurs en Europe au nom d’un supposé « anti-impérialisme » ou d’une « laïcité » tout aussi factice.
Du conflit israélo-palestinien aux guerres d’Irak et de Syrie, en passant par la gangrène djihadiste, on a parfois le sentiment qu’une malédiction frappe les peuples arabes ?
Mon livre s’efforce justement de démontrer, en retrouvant le temps long de l’histoire, qu’il n’y a aucune « malédiction » dans cette trop longue souffrance des peuples arabes. C’est au contraire la persistance de la volonté de libération, la poursuite envers et contre tout des combats pour l’autodétermination qui est fascinante dans le monde arabe. Ce sont les despotes comme les djihadistes qui veulent rejeter définitivement les populations arabes dans les oubliettes de l’histoire, afin que nous nous détournions d’elles et de leurs luttes, en France et ailleurs.
Malgré tout, vous annoncez que « le totalitarisme de Daesh finira par céder ». D’où vient cet incroyable optimisme ?
Je suis historien, je n’ai donc à être ni optimiste ni pessimiste, mais je replace les évolutions en cours dans les tendances de longue durée. L’émergence de Daesh est directement liée à la dynamique contre-révolutionnaire de régimes prêts à tout, en Syrie, au Yémen ou en Égypte, pour refuser la moindre concession. Or ce processus contre-révolutionnaire aboutit partout à une effroyable impasse en termes humains et financiers, aggravée par la chute spectaculaire des cours du pétrole. Le modèle contre-révolutionnaire n’est pas tenable et Daesh entrera en crise avec lui. Comme tous les groupes totalitaires avant lui, Daesh aura en outre à gérer le choc de la réalité, que lui épargne pour l’heure l’invraisemblable aveuglement des États-Unis. Ce sont les peuples arabes, et eux seuls, qui pourront défaire Daesh. Il est grand temps de le comprendre dans les capitales occidentales et d’apporter le soutien indispensable à ces forces populaires, plutôt qu’à des dictatures condamnées à court ou moyen terme.
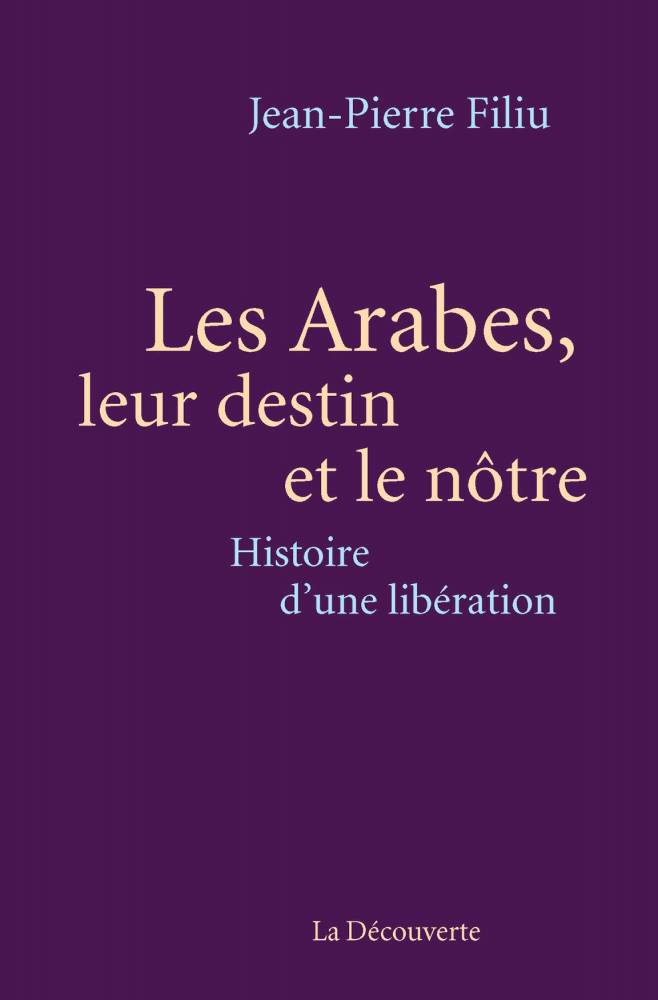
date : 27/08/2015